Isabelle Autissier - La célèbre navigatrice est ancrée à La Rochelle depuis le début des années 1980. La course au large, la mer, l’écologie… Rencontre avec une femme d’engagement.
Pour sa troisième édition, le festival Les Mémoires de la mer, qui s’est tenu les 20 et 21 octobre à Rochefort, s’est offert deux parrains et une marraine de choix : l’académicien Erik Orsenna, l’explorateur Jean-Louis Étienne et la navigatrice Isabelle Autissier. À tout juste 66 ans, celle qui fut la première femme...
Il vous reste 90% de l'article à lire.
Vous devez bénéficier d'un abonnement premium pour lire l'article.
Abonnement sans engagementDéjà abonné ? Connectez-vous
A lire aussi





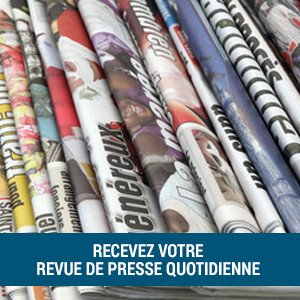

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.