Saint-Savinien - Mi-avril, les élus départementaux se sont réunis pour faire le point sur le vaste chantier de dévasement de la Charente. Coup de projecteur sur ce projet hors-norme.
Le 14 avril dernier au matin, le soleil rayonnait sur le port de Saint-Savinien. Difficile dans ces conditions d’imaginer les dégâts occasionnés par les importantes inondations de ces dernières années. C’est pour les prévenir que le...
Il vous reste 90% de l'article à lire.
Vous devez bénéficier d'un abonnement premium pour lire l'article.
Abonnement sans engagementDéjà abonné ? Connectez-vous
A lire aussi





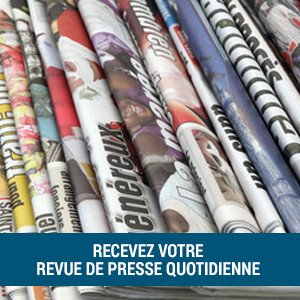

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.